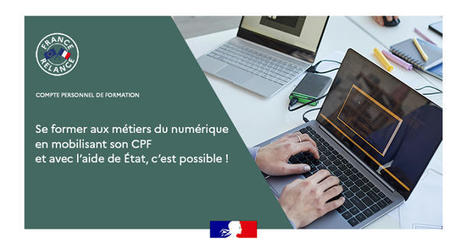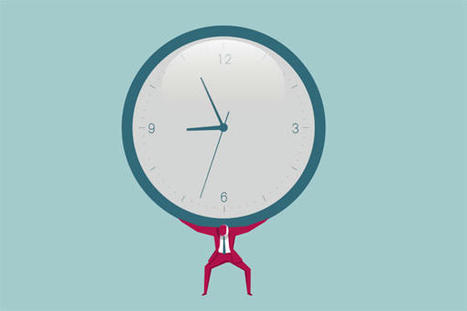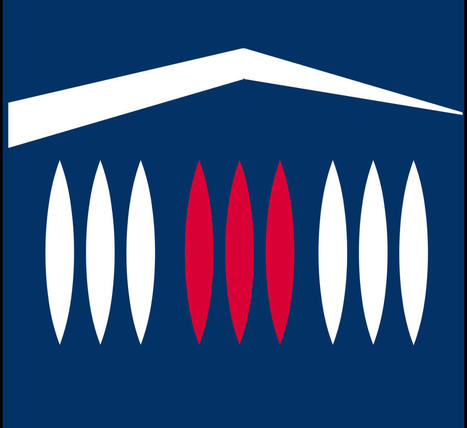Your new post is loading...

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 5, 2021 4:23 AM
|
Les titulaires d’un compte personnel de formation (CPF) qui souhaitent utiliser leur compte pour se former aux métiers stratégiques du numérique peuvent désormais obtenir un financement complémentaire de l’État.
Dans le cadre du plan «France Relance», l’État a décidé de mettre en œuvre une politique d’abondement en droits complémentaires dans le cadre du Compte personnel de formation (CPF), mobilisable grâce à «Mon Compte Formation».
L’adaptation des compétences des actifs est, en effet, l’un des volets du plan de relance destiné à renforcer la compétitivité de plusieurs secteurs stratégiques pour l’économie nationale et qui ont été fragilisés par la crise sanitaire.
Quelles formations l’État soutient-il avec cet abondement ?
La règle d’abondement définie s’adresse à tout titulaire d’un CPF (salarié, demandeur d’emploi, travailleur indépendant, etc.) pour une formation du domaine du numérique (exemples : développeur web, créateur et administrateur d’un site internet, technicien d’assistance en informatique, etc.).
L’abondement est déclenché si le solde du compte est insuffisant pour payer la formation. Le montant de l’abondement peut être de 100% du reste à payer dans la limite de 1 000 € par dossier de formation. L’abondement de l’État n’est pas exclusif d’un abondement par un autre financeur ou le titulaire lui-même.
Comment fonctionne l’abondement ?
L’abondement est lié à un dossier de formation : il est proposé automatiquement aux titulaires éligibles, dans leur recherche de formation sur le portail ou l’application mobile. Ceux-ci ont ensuite juste à «cliquer» pour activer l’abondement dont le montant est calculé en fonction de leur besoin.
Les abondements viennent toujours en complément des droits acquis annuellement. Il est mobilisable à la demande du titulaire en cas de reste à payer pour financer son projet de formation. Lorsque le titulaire remplit les conditions définies par l’État, cette information lui est affichée automatiquement dès sa recherche de formation au sein du catalogue des formations de «Mon Compte Formation».
Comment savoir si vous pouvez bénéficier de cette aide financière ?
Connectez-vous sur votre espace «Mon Compte Formation».
Si vous cherchez une formation dans le domaine du numérique (exemples : développeur web, créateur et administrateur d’un site internet, technicien d’assistance en informatique…), l’aide financière de l’État vous sera automatiquement proposée.
L’abondement est déclenché si le solde du compte est insuffisant pour payer la formation.
Le montant de l’abondement peut être de 100% du reste à payer dans la limite de 1 000 € par dossier de formation. L’abondement de l’État n’est pas exclusif d’un abondement par un autre financeur ou le titulaire lui-même.
Comment activer cette aide sur «Mon Compte Formation» !?
L’abondement est lié à un dossier de formation : il vous est proposé automatiquement dans votre recherche de formation sur le portail ou l’application mobile. Vous pouvez ensuite l’activer au retour de la proposition de l’organisme de formation et son montant est calculé en fonction de votre besoin. Les abondements viennent toujours en complément des droits acquis annuellement.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 4, 2021 3:01 AM
|
Le retour de la réforme des retraites est annoncé pour la rentrée. Les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux vont reprendre en septembre, autour d'enjeux modifiés par la crise sanitaire, mais en partie seulement. La nécessité d'équilibrer le système à long terme est toujours là, y compris pour les régimes de la territoriale.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 3, 2021 4:50 AM
|
La première fiche s’est attachée à la formation et à la promotion des agents relevant des cadres d’emplois de police municipale à travers les nouvelles dispositions apportées par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cette fiche va étudier les changements dans le dialogue social introduits par la loi de transformation de la fonction publique, en se concentrant sur le renouveau du fonctionnement des commissions administratives paritaires (CAP).

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 3, 2021 4:35 AM
|
Parmi les principales dispositions de ce texte
LA PREVENTION AU TRAVAIL RENFORCEE
- Le contenu du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) est renforcé. Une conservation successive du document devra se faire pour assurer la traçabilité collective des expositions. Pour garantir cette conservation le dépôt dématérialisé du DUERP et de ses mises à jour sur un portail numérique est géré par les organisations d’employeurs.
- Les missions des services de santé au travail (SST), qui deviennent les "services de prévention et de santé au travail" (SPST), sont étendues (évaluation et prévention des risques professionnels, actions de promotion de la santé sur le lieu de travail...). Les SPST seront notamment chargés des campagnes de vaccination et de dépistage ainsi que d'autres missions : conseils en matière de conditions de télétravail...
- La création du passeport de prévention. Toutes les formations suivies par le travailleur sur la santé et la sécurité devront figurer dans ce passeport. Les demandeurs d'emploi ont la possibilité d'ouvrir ce passeport. Le passeport de prévention sera intégré dans le passeport d’orientation, de formation et de compétences si le salarié ou demandeur d'emploi en possède un.
- La définition du harcèlement sexuel au travail. Le harcèlement sexuel au travail est matérialisé lorsqu’il est subi par le salarié et non pas lorsqu’il est imposé par l’auteur ou les auteurs.
L'OFFRE DES SERVICES DE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL REVUE
- La qualité du service rendu par les services de santé au travail. Ces derniers devront offrir un socle de services et feront l'objet d'une procédure de certification et d'agrément. Leurs règles de tarification sont revues.
Un décret doit intervenir pour encadrer davantage la fixation du niveau des cotisations de l'offre socle de services
- Afin d'assurer un meilleur suivi des travailleurs, l'accès au dossier médical partagé (DMP) est ouvert au médecin du travail qui pourra l'alimenter. Un volet relatif à la santé au travail complétera le DMP. Il sera accessible aux médecins et professionnels de santé du patient.
DES DISPOSITIFS POUR LUTTER CONTRE LA DESINSERTION PROFESSIONNELLE
- Les SPST devront mettre en place une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle.
- Les médecins du travail pourront recourir à la télémédecine.
- Une visite de mi-carrière professionnelle (à 45 ans à défaut d'accord de branche) et un rendez-vous "de liaison" (en vue du retour du salarié après une absence prolongée) sont créés.
- Le suivi en santé au travail est étendu aux intérimaires, aux salariés des entreprises sous-traitantes ou prestataires comme aux travailleurs indépendants.
UNE NOUVELLE GOUVERNANCE DE LA SANTE AU TRAVAIL
- adaptation de l’organisation interne des SPST, en élargissant les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer une partie de ses missions à d’autres membres de l'équipe de santé et en renforçant le pilotage national.
- les médecins de ville pourront contribuer au suivi médical des travailleurs et le statut d'infirmier en santé au travail est consacré.
- expérimentation dans trois régions volontaires permettant à des médecins de travail de prescrire des arrêts des travail et des soins liés à la prévention au travail.
- un comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), aux compétences étendues, est institué au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail.
Un article prévoit les conditions de la fusion des agences régionales pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT) avec l'Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT). Un décret doit intervenir avant 2023.
----------------------------------
Les mesures du texte doivent s'appliquer au plus tard avant avril 2022. Des dates butoirs différentes ont été fixées par le Sénat notamment au 1er octobre 2022 pour le passeport prévention, au 1er janvier 2023 pour le médecin praticien correspondant et au 1er janvier 2024 pour le volet relatif à la santé au travail du DMP.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 2, 2021 3:57 AM
|
Si le message "l'application vient de rencontrer un problème technique (no260) sur ce dossier (code ano. d'origine : 189)" s'affiche suite à une demande dossier, celle-ci ne pourra pas être prise en compte.
L'incident est en cours de correction par les services de la CNRACL qui vous tiendrons informés dès sa résolution.
Vous êtes susceptibles de rencontrer cette anomalie lors d'une demande de dossier dans les services :
- Gestion des comptes individuels retraite CNRACL,
- Qualification des comptes individuels retraite CNRACL,
- Estimation de pension CNRACL,
- Demande d'avis préalable CNRACL,
- Liquidation de pensions CNRACL.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 29, 2021 3:34 AM
|
L’affaire des vols de sacs poubelle commis par un agent municipal est close. Dans une décision du 13 juillet, le Conseil d’Etat reconnaît la faute disciplinaire mais ne valide pas pour autant la révocation de l’agent. Et non, ce n’est pas une reconnaissance du « droit de voler ».

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 29, 2021 3:24 AM
|
Décret n° 2021-989 du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de fixation du plafond de la sécurité sociale
>> Le plafond de la sécurité sociale est une valeur de référence servant à la détermination de l'assiette de calcul des cotisations vieillesse du régime général de sécurité sociale ainsi qu'à la détermination de certaines prestations et de certaines mesures dérogatoires de prélèvement social.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu que la valeur du plafond ne pouvait être inférieure à celle de l'année précédente.
Le décret détermine en conséquence les modalités de calcul du plafond, notamment pour les années suivant une reconduction de sa valeur.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 27, 2021 3:40 AM
|
Le 1er janvier 2022 sonnera le glas des régimes dérogatoires pour laisser place aux 1607 heures. Pour les agents, largement mobilisés durant la crise sanitaire, c'est la réforme de trop tandis que certains élus de gauche y voient, à un an de l'élection présidentielle, l'occasion de réaffirmer leur opposition à la ligne du gouvernement.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 27, 2021 3:03 AM
|
Le pass sera exigible pour les personnels à partir du 30 août 2021. À défaut de présenter ce pass, leur contrat de travail pourra être suspendu, sans salaire. Une affectation sur un autre poste, sans contact avec le public, pourra leur être proposée.
La possibilité d'un licenciement pour défaut de pass sanitaire, initialement prévue par le gouvernement, a été supprimée par les sénateurs. Toutefois, les contrats de travail à durée déterminée (CDD) pourront être rompus par les employeurs.
Un décret doit préciser le document remplaçant le pass sanitaire pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination.
L'isolement des cas positifs pour dix jours
Jusqu'au 15 novembre 2021, toutes les personnes dépistées positives au Covid-19 devront s'isoler pendant dix jours à leur domicile, sauf opposition du préfet, ou dans un autre lieu adapté. L'isolement pourra prendre fin plus tôt en cas de nouveau test négatif au virus.
Les malades isolés ne pourront sortir qu'entre 10 et 12h ainsi qu'en cas d'urgence ou pour effectuer des déplacement indispensables hors de ce créneau. Ils pourront toutefois demander au préfet un aménagement pour raisons familiales ou personnelles.
En cas de violation de l'isolement, l'assurance maladie pourra saisir le préfet et les forces de l'ordre pourront procéder à des contrôles (sauf entre 23h et 8 h). Des sanctions sont applicables.
Les malades placés à l'isolement pourront à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention (JLD), qui devra statuer dans les 72 heures.
La vaccination obligatoire
La vaccination contre le Covid-19 est rendue obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social. Sont en particulier concernés :
- les professionnels médicaux et paramédicaux qui exercent en libéral ou dans les hôpitaux, les cliniques, les Ehpad et les maisons de retraite, ainsi que les professionnels, étudiants ou élèves qui travaillent dans ces locaux ;
- les professionnels en contact avec des personnes vulnérables, comme les pompiers, les ambulanciers, les employés au domicile de certains bénéficiaires de l’allocation personnalisé d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Les personnels non vaccinés auront jusqu’au 15 septembre 2021 pour le faire, voire jusqu'au 15 octobre 2021 s'ils ont déjà reçu une première dose de vaccin. Un certificat de statut vaccinal leur sera délivré.
À défaut d'avoir été vaccinés dans les temps, les salariés et les agents publics pourront être suspendus, sans salaire. La possibilité d'un licenciement en cas de défaut de vaccination, initialement prévue par le gouvernement, a été également supprimée par les parlementaires pour les soignants.
Les autres mesures
Toujours afin de faciliter la vaccination, les salariés et les agents publics bénéficieront d'une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous vaccinaux. Leur employeur pourra aussi leur accorder une autorisation pour accompagner leurs enfants mineurs à la vaccination.
La dérogation à l'application du jour de carence pour les agents publics en congés de maladie directement liés au Covid-19 est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2021.
Passe sanitaire : qu’en est-il du licenciement ?
Public Senat >> Article complet

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 26, 2021 3:54 AM
|
Le décret 2021-904 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique vient compléter l'ordonnance 2021-174 relative aux mêmes sujets. L'UNSA Fonction publique vous propose un décryptage de ces textes.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 26, 2021 3:52 AM
|
Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...)

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 23, 2021 4:44 AM
|
Ce guide est issu d’un travail de longue haleine réalisé par des magistrat·e·s administratif·ve·s, des juristes, des avocat·e·s, des syndicalistes, des militant·e·s et agents publics de tous horizons.
1 / Il existe une grande variabilité - au risque de l’illisibilité - dans l’application du devoir de réserve, que ce soit par les autorités hiérarchiques ou par les juges administratifs qui peuvent être saisis d’éventuelles sanctions. L’appréciation du respect de la modération et du devoir de réserve varie en effet selon la nature des propos, selon la situation des fonctionnaires, selon la publicité des déclarations, mais aussi selon l’air du temps et les juges effectivement présent·e·s lors du jugement. Nous essayons d’en donner la lecture la plus simple possible. À regret, il nous faut bien constater que ce qui est permis ou non à des agents publics en matière d’expression publique doit être appréhendé avec prudence et recul, et en ayant conscience du caractère évolutif de la notion de devoir de réserve.
2/ Les limites à l’expression publique des fonctionnaires sont très souvent sur-interprétées, y compris - voire avant tout - par les agents publics eux-mêmes. Il existe un « halo » du devoir de réserve qui nous pousse à passer sous silence nos désaccords ou les limites des politiques publiques que nous mettons en œuvre. Le prix de ce mutisme est le mépris non seulement de l’efficacité de nos services publics, qui nécessiterait que nous puissions faire remonter les problèmes, mais aussi des principes démocratiques, qui mériteraient que les dysfonctionnements publics soient débattus publiquement.
3/ La protection de l’expression publique des agents publics est d’abord collective avant d’être juridique. Au-delà du droit, notre capacité d’expression dépendra de notre relation avec notre hiérarchie, du soutien dont nous disposerons, voire de l’impact de notre expression. Nous avons la double conviction que les problèmes que nous rencontrons ne sont jamais isolés, et que notre première protection viendra toujours de nos collègues. Parlons autour de nous avant de parler publiquement ! Notre principal outil d’expression et de protection sera toujours le collectif.
L’ESSENTIEL
- Le principe général pour une ou un agent public en dehors de ses fonctions est la liberté d’opinion, qui ouvre une très large palette de droits en tant que citoyen ou citoyenne.
- L’expression publique des fonctionnaires et contractuel·le·s s’exerce dans le respect du devoir de discrétion qui s’impose aux informations dont ils ou elles ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que dans le cadre général de la liberté d’expression (interdiction de l’incitation à la haine, à la violence, etc.).
- Le devoir de réserve s’applique uniquement aux propos tenus en
dehors de nos fonctions, jamais à ceux tenus dans l’exercice du cadre professionnel où la règle est celle de la neutralité.
- Il est une exception, limitée, au principe légal de liberté d’opinion, qui a une valeur supérieure au devoir de réserve. Il est synonyme de « modération » des propos publicisés des agents publics en dehors de l’exercice de leurs fonctions.
- Le devoir de réserve est apprécié en premier lieu par la hiérarchie, et rentre dans le cadre disciplinaire. Autrement dit, tout propos qui ne sera pas relevé par la hiérarchie ou qui ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire est par principe autorisé.
- C’est une construction essentiellement jurisprudentielle, c’est-à-dire que son périmètre dépend de l’interprétation qu’en donnera ex post la ou le juge administratif, qui est variable.
- L’obligation de réserve est plus stricte pour les fonctionnaires ou contractuel·le·s occupant des responsabilités importantes ou exerçant dans des domaines dits «régaliens ». Elle est également appréciée plus strictement lorsque les propos font l’objet d’une publicité particulière.
- Elle est plus faible pour les agents exerçant des responsabilités syndicales, dans l’exercice de ces fonctions.
- La première des protections pour la prise de parole reste et restera le collectif. Parlez à vos collègues, syndiqué·e·s ou non, et parlez ensemble !
- En cas de procédure enclenchée pour « manquement » au devoir de réserve par l’autorité hiérarchique, un très grand nombre de voies de recours sont disponibles. N’hésitez pas à vous faire assister par un ou une avocat·e et/ou un syndicat.
- La parole des agents publics est d’utilité publique : prenons-la !

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 23, 2021 4:39 AM
|
Aux termes du premier alinéa de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. ".
Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ".
En l'espèce, M. D..., convoqué le 21 décembre 2018 à un entretien fixé au 9 janvier 2019, y a mis un terme de façon unilatérale et anticipée au bout d'une discussion d'une heure et trente minutes, obligeant ainsi sa supérieure hiérarchique directe à lui adresser une nouvelle convocation, le 11 janvier 2019, pour un entretien complémentaire, qui s'est tenu le 21 janvier 2019 et a duré deux heures et trente minutes. A l'issue de ce second entretien, après avoir pris connaissance du compte rendu établi par sa supérieure hiérarchique directe, le requérant a refusé de le signer.
En réaction au comportement de l'agent, le directeur général des services a assorti sa signature du compte rendu de l'observation suivante : " 4 heures d'entretien, refus de signer. Quel manque de respect vis-à-vis de votre hiérarchie ! ".
A supposer même, ainsi que le fait valoir M. D..., qu'une telle observation présentait un caractère tendancieux et inapproprié, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, qu'elle aurait eu une incidence quelconque sur l'appréciation portée par la supérieure hiérarchique directe sur la manière de servir de l'intéressé au titre de l'année 2018, ni qu'elle aurait pour objet ou pour effet de contrarier ses perspectives de carrière et de mobilité. Par suite, les moyens tirés de ce que le compte rendu en litige, eu égard à la teneur de l'observation du directeur général des services, serait entaché d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore de détournement ne peuvent qu'être écartés.
|

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 5, 2021 4:20 AM
|
Les centres départementaux de gestion calculent le contingent des décharges d'activité de service accordées aux responsables des organisations syndicales représentatives pour les seuls collectivités et établissements obligatoirement affiliés et non pour les collectivités et établissements affiliés à titre volontaire aux centres de gestion.
En l’espèce, le syndicat mixte requérant relève de l'article L. 5721-2 du CGCT selon lequel, dans sa rédaction applicable en l'espèce, " un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. ".
Outre la région Grand Est, le département de la Moselle, le département du Bas-Rhin, plusieurs communes et établissements publics intercommunaux, il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte requérant est constitué de plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers ainsi que de l'Office national des forêts.
Par suite, alors même que le syndicat mixte requérant emploie moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, il n'est pas au nombre des établissements publics communaux et intercommunaux qui sont obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 et du d) du 1° de l'article 2 du décret du 26 juin 1985, cités au point 7. La circonstance qu'il ne serait pas davantage au nombre des " syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département " au titre du d) du 2° de l'article 2 du même décret cité au point 7, pouvant s'affilier à titre volontaire au centre de gestion départemental, ne saurait nécessairement lui conférer la qualification d'établissement public communal et intercommunal obligatoirement affilié à un centre de gestion en application de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 et du d) du 1° de l'article 2 de ce décret.
En deuxième lieu, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du III bis de l'article 33-1, issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, entrées en vigueur le 22 avril 2016, lesquelles n'étaient pas applicables lorsque les décisions contestées ont été prises, date à laquelle leur légalité s'apprécie.
Il résulte de ce qui précède que, sans que la méconnaissance, par le tribunal administratif de Strasbourg, de ses obligations en matière d'administration de la charge de la preuve puisse être utilement invoquée pour contester la légalité des décisions contestées, c'est à bon droit que le centre de gestion a pu refuser de prendre en charge la décharge d'activité de M. C... sur son contingent d'heures au motif que le syndicat requérant n'était pas un établissement obligatoirement affilié.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 4, 2021 2:59 AM
|
Mise en œuvre de la formation à la langue des signes française par les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants
L'article 106 de la loin° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative a !'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique prévoit que les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants proposent a au mains un de leurs agents et a titre expérimental pour une durée maximale de trois ans, une formation à la langue des signes française au titre des formations de perfectionnement.
Le même article précise que les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.
La mesure législative étant d'un niveau de clarté et de précision suffisant pour être directement appliquée, elle ne nécessite aucune mesure d'application de niveau règlementaire.
Par ailleurs, cette formation ne relève pas des formations statutaires obligatoirement prises en charge par le CNFPT sur la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et plafonnée par la loi a 0,9% de leur masse salariale. Elle peut ainsi être réalisée par un prestataire choisi par la collectivité, ce prestataire pouvant également être le CNFPT qui propose déjà une formation de cette nature à son catalogue.
La durée et le type de formation sont également laisses à l'appréciation des employeurs territoriaux en fonction des actions de formation proposées et des besoins identifiés par les collectivités en matière d'accessibilité. A titre d'exemple, il peut ainsi être opportun de former des agents des écoles, garderies et autres structures d'accueil de l'enfance pour accompagner les enfants confrontes a ce type de handicap.
La législation n'a prévu aucune sanction en cas de non-respect de cette mesure par les collectivités concernées.
Néanmoins, les préfets rappelleront cette obligation aux collectivités de plus de 10 000 habitants et leur indiqueront qu'il s'agit de renforcer l'accessibilité des services des collectivités aux personnes sourdes ou malentendantes
Circulaire 221-011735-D

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 3, 2021 4:45 AM
|
Partant d’un double constat de la difficulté de comparer les différentes «fonctions publiques locales» en Europe et l’impérieuse nécessité de le faire, l’étude met en lumière les éléments clés de ces différents systèmes de formation, avec leurs avantages et inconvénients, afin de comprendre comment améliorer les compétences et qualifications de façon à renforcer l’efficience du service public.
Surtout, elle offre la possibilité de jauger du niveau d’avancement des différents pays européens en termes d’autonomie locale et de démocratie. En effet, alors que dans certains pays, le droit pour les fonctionnaires de recevoir une formation est inscrit dans la Constitution, dans d’autres, cette même formation est à la charge de l’agent. Deux tendances se dessinent toutefois concernant les types de formations : le premier, un système de formation universitaire ; le second, plus long, avec une école d’application postuniversitaire qui continue la formation.
A noter qu'il n’existe pas de modèle européen pour le niveau local et que les situations sont très hétérogènes. Que ce soit en Europe occidentale ou centrale, dans les Etats Fédéraux ou unitaires, le service public est confronté à une problématique commune : celle d’adapter son personnel et ses élus à une multitude de changements et un cadre réglementaire en constante évolution, tout en répondant de la manière la plus efficace possible aux besoins des citoyens, de plus en plus exigeants.
Face à ces défis, il est évident que le niveau de formation des élus et des agents locaux, leur capacité d’adaptation ainsi que leurs qualifications doivent progresser, à l’ère des grandes transitions (numérique, écologique et énergétique, démographique et sociale, démocratique et institutionnelle), de l’expansion du secteur privé et de la crise démocratique qui touche l’Europe et le monde.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 2, 2021 3:58 AM
|
Les complémentaires santé - La réforme de la couverture des agents publics, pourrait porter préjudice au secteur des mutuelles (rapport Cours des Comptes)
Contrairement à plusieurs de ses voisins, la France n’a pas choisi de mettre en place un système de plafonnement des dépenses annuelles de santé des ménages, ou «bouclier sanitaire», mais a privilégié le recours aux assurances complémentaires afin d’atténuer le reste à charge des ménages. Dans ce but, de nombreuses mesures incitatives ont été prises et un dispositif public spécifique, la complémentaire santé solidaire, a été institué pour les personnes les plus fragiles financièrement. Le système ainsi mis en place permet d’assurer à 96 % de la population une protection parmi les plus complètes, bien qu’en partie inégalitaire et au prix de dépenses fiscales et sociales très élevées (10 Md€).
Le haut niveau de couverture offert par le système français combinant assurances obligatoire et complémentaires, s’avère néanmoins coûteux, favorable aux salariés du secteur privé, au détriment de ceux du public et plus encore des inactifs, en particulier les retraités. Le dispositif public, la complémentaire santé solidaire, complexe, manque, par ailleurs, en partie sa cible, pourtant vulnérable.
Une couverture des agents publics faible et inégale
Un rapport de l’IGF, de l’IGA et de l’Igas, intitulé «protection sociale complémentaire des agents publics», publié en octobre 2020, est venu relancer le débat sur le devenir de la protection sociale des agents publics, en soulignant la forte iniquité de traitement entre ministères. Si le montant annuel moyen du financement apporté par l’État, pour la fonction publique d’État, s’y élève à 12 €, il atteint 47 € par agent à l’Agriculture, mais seulement 3 € à l’Éducation nationale (205 € en moyenne dans les collectivités territoriales, où la situation est, elle-même, très hétérogène).
La réforme de la couverture des agents publics, en faveur d’une complémentaire collective obligatoire, progressivement mise en œuvre par l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique devrait permettre d’apporter une plus grande équité entre agents publics, ainsi qu’entre agents publics et salariés du privé. Une telle évolution pourrait toutefois porter préjudice au secteur des mutuelles, historiquement très présentes sur ce segment de marché. En leur faisant perdre la clientèle des agents publics, leur dépendance envers les personnes âgées, déjà très présentes dans leur portefeuille, risque de renchérir d’autant le montant des cotisations qu’elles demandent à ces dernières, en raison des risques accrus entrainés par leur âge et par leur absence de pouvoir de négociation, à la différence des branches professionnelles et des entreprises de taille importante
De nombreuses faiblesses peuvent être corrigées.
La Cour formule plusieurs recommandations en ce sens. Elles ne résolvent toutefois pas totalement les problèmes les plus difficiles mis en évidence par l’enquête de la Cour, ce qui ouvre la perspective de choix de plus long terme : mettre en place un bouclier sanitaire ; désimbriquer les interventions respectives de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance complémentaire ; approfondir la régulation existante, en assurant une transparence accrue des offres, tout en encadrant le niveau des frais de gestion, voire du prix des garanties elles-mêmes.
Recommandations générales :
1. Prendre sans délai l’arrêté d’application de la loi portant information sur les remboursements proposés par les complémentaires santé et contrôler sa bonne application (DSS).
2. Augmenter la périodicité et élargir le champ des études menées par la Drees portant sur la CSS à la consommation de soins de ses bénéficiaires par rapport à ceux qui n’en disposent pas, en neutralisant les impacts des différences d’âge, de sexe et de prévalence de pathologies (Drees).
3. Procéder, après trois années de mise en œuvre, au bilan de la réforme du 100 % santé (DSS).
Recommandations de simplification
4. Dans le cadre de la réforme des minima sociaux, homogénéiser l’assiette de la CSS sur celle du revenu universel d’activité (DSS).
5. Expérimenter, en s’appuyant sur les données rassemblées dans le dispositif ressources mutualisé mis en place dans le cadre de la réforme des aides au logement, tout en veillant à conserver la liberté de choix quant à l’organisme gestionnaire de la couverture santé :
- l’attribution automatique de la CSS pour les bénéficiaires du RSA et des autres minimas sociaux (ASS, ASI, AAH et Aspa), sauf décision contraire de leur part ;
- le renouvellement automatique de la CSS pour les bénéficiaires de l’AAH et de l’ASI, pour les étudiants boursiers et pour les retraités modestes, (DSS, Cnam). Rapport complet «Les complémentaires santé : un système très protecteur mais peu efficient»

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 29, 2021 3:35 AM
|
Nombre de métiers de la FPT sont pénibles physiquement et caractérisés par des horaires atypiques. Pour les agents « C », qui les exercent, la hausse du temps de travail est d’autant plus rude qu’ils sont restés mobilisés durant la pandémie. Quatre d'entre eux ont raconté leur quotidien à la Gazette.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 29, 2021 3:30 AM
|
Alors que l’année 2020 est présentée comme exceptionnelle en matière d’apprentissage avec 510.000 contrats signés contre 353.000 en 2019, 2021 fera-t-elle aussi bien ? Rien n’est moins sûr.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 28, 2021 3:34 AM
|
Conséquences des réformes statutaires en matière de prolongation d'activité Les réformes statutaires peuvent avoir un impact sur le classement des services en catégorie active et par extension sur les droits à pension (départ anticipé, limite d'âge, majoration de durée d'assurance). Dans certains cas, les textes peuvent prévoir un dispositif de droit d'option au bénéfice des agents.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 27, 2021 3:39 AM
|
Annoncé à partir de la rentrée, le « resculptage » des grilles de rémunération semble difficilement faisable avant la fin du quinquennat.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 27, 2021 2:57 AM
|

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 26, 2021 3:53 AM
|
Aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l'article 10 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les commissions administratives paritaires (CAP) ne sont plus consultées sur les décisions relatives à l'avancement de grade et à la promotion interne, depuis le 1er janvier 2021.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 26, 2021 3:49 AM
|
Décret n° 2021-977 du 23 juillet 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
>> Ce décret modifie les modalités de mise en œuvre des aides à l'acquisition de véhicules peu polluants
Il prévoit notamment la possibilité pour toutes les collectivités territoriales ou EPCI de signer une convention avec l'Agence de services et de paiement pour mettre en place un guichet unique pour les aides de l'Etat et les aides locales.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
July 23, 2021 4:42 AM
|
Avec la loi du 6 aout 2019, le CNFPT s’est vu confier une compétence nouvelle de financement partiel des frais de formation des apprentis des collectivités territoriales. L'établissement a engagé la mise en place opérationnelle de ce principe dès que le cadre juridique réglementaire a été défini par le décret du 26 juin 2020. Les CFA et les collectivités locales ont alors dû s’approprier ces nouvelles modalités, ce qui a induit une transmission tardive des contrats 2020. En effet, plus de 7500 contrats d’apprentissage ont été reçus au titre de 2020. Sur ce volume, 2000 dossiers de financement restent encore à instruire.
La situation est toutefois variable d’une région à une autre au regard de la dynamique des recrutements locaux.
Afin de fluidifier les instructions des contrats et accélérer les paiements, une plateforme en ligne est opérationnelle depuis le 5 juillet. Ce service permet aux CFA :
- De déposer facilement l’ensemble des informations et des pièces jointes pour chaque demande,
- D’accéder à leur tableau de bord pour suivre l’état d’avancement du portefeuille de demandes,
- De visualiser l'échéancier de paiement et de faciliter le traitement des factures.
Le CNFPT met ainsi tout en œuvre pour stabiliser et optimiser le système mis en place. Le concours des collectivités territoriales est demandé afin que les dossiers présentés, tant à l’instruction administrative qu’au paiement, respectent toutes les consignes transmises et pour limiter les demandes d’information et relances liées au délai de traitement.
Retrouvez toutes les infos relatives à l'apprentissage sur la page dédiée de notre portail.
|




 Your new post is loading...
Your new post is loading...