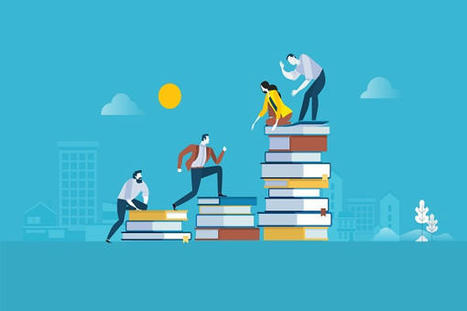Your new post is loading...

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 16, 2021 5:37 AM
|
Question écrite n° 21854 de M. Gilbert Favreau (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 01/04/2021 - page 2147 M. Gilbert Favreau attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement au service public de location de vélos à assistance électrique (VAE) pour les agents des fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière. Ces services de location publics de VAE offrent aux habitants une nouvelle offre de mobilité durable et les incitent à utiliser des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. Toutefois, à la différence des salariés de droit privé, les agents publics se voient refuser la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement au service de location public de vélos à assistance électrique par leur employeur. Le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 prévoit les conditions de cette prise en charge par l'employeur et une circulaire du 22 mars 2011 est venue préciser les modalités d'application.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 16, 2021 5:32 AM
|

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 16, 2021 5:30 AM
|

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 16, 2021 5:26 AM
|

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 16, 2021 5:23 AM
|

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 16, 2021 5:05 AM
|
Depuis la loi "Avenir professionnel", les compétences des régions en matière de formation et apprentissage ont évolué.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 16, 2021 2:57 AM
|
Pour l'application du décret du 6 juin 2008 susvisé, pour la période de référence fixée du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2020, le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l'article 3 du même décret sont les suivants :
- taux de l'inflation : + 3,78 % ;
- valeur moyenne du point en 2016 : 55,7302 euros ;
- valeur moyenne du point en 2020 : 56,2323 euros.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 13, 2021 4:15 AM
|
Ce décret fixe les conditions d'éligibilité des communes ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'aide destinée à soutenir les communes dans leur effort de production d'une offre de logement plus sobre en matière de consommation foncière en les accompagnant financièrement dans le développement d'équipements publics, infrastructures et autres aménagements d'aménités urbaines favorables à l'accueil de nouveaux ménages et à l'amélioration du cadre de vie des habitants.
L'aide s'applique aux décisions de non opposition à déclaration préalable et aux permis de construire créant au moins deux logements délivrés entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 sous certaines conditions.
L'aide est versée automatiquement, à partir des informations relatives aux déclarations préalables et aux permis de construire transmises par les autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations d'urbanisme et collectées dans la base de données Sitadel, pour tout mètre carré de logement nouvellement créé au-delà d'un seuil de densité fixé selon une classification des communes au regard de leurs caractéristiques urbaines.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 13, 2021 3:48 AM
|
Obligation de présentation d'un passe sanitaire sur le lieu de travail et vaccination obligatoire contre la Covid-19 dans la FPT - Note d’information de la DGCL (mise à jour du 11/08/2021)
La présente note d'information vise à préciser les modalités de mise en œuvre de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire et de l'obligation de vaccination contre la Covid-19 (2) dans la fonction publique territoriale.
1 - Modalités de mise en œuvre de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire
L'article 1er de la loi du 5 août 2021 crée une obligation de présentation d'un passe sanitaire pour certains agents territoriaux, conditionnant la poursuite de leur activité, à compter du 30 août prochain et jusqu'au 15 novembre 2021 au plus tard
1.1 Champ d'application de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire
L'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 modifié définit le champ d'application de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire. Il vise notamment les établissements et services suivants dans lesquels exercent des agents de la fonction publique territoriale:
- Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche;
- Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l'exception des bibliothèques spécialisées et des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche;
- Les établissements de plein air, relevant du type PA dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle : terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes;
- Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L;
- Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
A compter du 30 août 2021, l'obligation de présentation d'un passe sanitaire s'appliquera aux au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence. Pour les apprentis de moins de 18 ans, cette obligation entrera en vigueur à compter du 30 septembre 2021.
1.2 Conditions de satisfaction de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire
Les agents territoriaux soumis à l'obligation de présentation d'un passe sanitaire sont tenus de justifier de leur situation auprès de leur employeur par la présentation d'un des justificatifs suivants :
- la preuve d'un test négatif de moins de 72 heures;
- un certificat de statut vaccinal complet;
- un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19.
1.3 Les modalités de contrôle du respect de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire
Il incombe aux employeurs territoriaux de contrôler le respect de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire pour les agents placés sous leur responsabilité. Conformément à l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié, il appartient à chaque employeur d'habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs et de tenir un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.
Le justificatif produit par l'agent doit satisfaire aux préconisations fixées à l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié. Comme le prévoit la loi, les agents publics qui exercent leurs fonctions dans un lieu où le passe est obligatoire peuvent, uniquement à leur initiative, présenter à leur employeur un justificatif montrant que leur schéma vaccinal est complet.
Dans ce cas, l'employeur peut le conserver jusqu'à ce que le passe ne soit plus obligatoire pour l'agent et leur délivrer le cas échéant un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.
1.4 Les conséquences du manquement à l'obligation de présentation d'un passe sanitaire
A défaut d'avoir présenté les justificatifs, certificats ou résultats mentionnés au 1.2, l'agent territorial concerné ne peut plus exercer son activité. Son employeur l'informe alors sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
L'intéressé peut, avec l'accord de son employeur, poser des jours de congés ou des jours de d'aménagement et de réduction du temps de travail. À défaut, il se voit notifier par son employeur, par tout moyen, le jour même la suspension de ses fonctions. La notification peut notamment s'effectuer par remise en main propre contre émargement ou devant témoins d'un document écrit prononçant la suspension des fonctions résultant de l'absence de présentation des justificatifs requis.
La suspension entraîne alors l'interruption de sa rémunération. En outre, elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
Lorsque l'agent suspendu n'a pas régularisé sa situation passé un délai de trois jours, son employeur le convoque à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à l'obligation de présentation du passe sanitaire au regard des besoins de service ou d'envisager, le cas échéant, le recours au télétravail si les missions le permettent. L'agent peut être accompagné lors de l'entretien.
La suspension se poursuit tant que l'agent ne présente pas les justificatifs requis. Elle prend fin dans tous les cas, le 15 novembre au plus tard, échéance fixée par le législateur.
2 - Modalités de mise en œuvre de la vaccination obligatoire contre la Covid-19
L'article 12 de la loi du 5 août 2021 précitée crée une obligation de vaccination contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, pour certaines catégories d'agents territoriaux, conditionnant la poursuite de leur activité, à compter du lendemain de sa publication soit le 7 août 2021.
2.1 Champ d'application de l'obligation de vaccination
Le I de l'article 12 définit le champ d'application de l'obligation de vaccination. Pour la fonction publique territoriale, il concerne les catégories suivantes de personnes:
Les agents territoriaux, titulaires et contractuels, quel que soit leur cadre d'emplois, exerçant leur activité dans certains établissements et services dont la liste est définie au 1° du I de l'article précité.
Sont notamment visés, s'agissant des agents des collectivités territoriales:
- Les centres de santé ;
- Les centres de lutte contre la tuberculose;
- Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic Les services de médecine préventive
- Les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et pour personnes handicapées tels que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les établissements d'hébergement pour personnes âgées, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile.
En outre, les agents territoriaux, titulaires et contractuels, professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, les professionnels exerçant les métiers de psychologue, ostéopathe, chiropracteur et psychothérapeute et ce quel que soit leur lieu d'affectation. Sont également soumis à l'obligation de vaccination les agents travaillant dans les mêmes locaux que ces professionnels.
Tel que précisé par l'article 49-2 du décret du 1er juin 2021 modifié, il convient d'entendre par «mêmes locaux» les espaces dédiées à titre principal à l'exercice de l'activité de ces professionnels ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.
En revanche, l'obligation vaccinale ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes précédemment mentionnées soumises à l'obligation vaccinale exercent ou travaillent. Un agent exerçant dans le même service mais pas dans l'espace dédié à ces professionnels n'est pas inclus dans l'obligation vaccinale.
Par ailleurs, les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours, quel que soit leur statut, sont également concernés par cette obligation vaccinale.
Le tableau joint en annexe de la présente note détaille les établissements et personnes visées par l'obligation de vaccination.
2.2 Mise en œuvre de l'obligation de vaccination
Les agents territoriaux soumis à l'obligation vaccinale sont tenus de justifier de leur situation auprès de leur employeur
- à compter du 7 août et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, par la présentation d'un certificat de statut vaccinal complet ou, à défaut , d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19 ou d'un justificatif de résultat négatif d'un examen de dépistage virologique;
- à compter du 15 septembre et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, par la présentation d'un certificat de statut vaccinal complet ou, à défaut, d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses requises de vaccin accompagné du résultat d'un test de dépistage virologique négatif;
- à compter du 16 octobre 2021, par la présentation d'un certificat de statut vaccinal complet
Les agents territoriaux justifiant d'une contre-indication médicale reconnue à la vaccination sont, pour leur part, exemptés de l'obligation de vaccination.
2.3 Modalités de contrôle du respect de l'obligation vaccinale
Il incombe aux employeurs territoriaux de contrôler le respect de l'obligation vaccinale pour les agents placés sous leur autorité. Conformément à l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié, il appartient à chaque employeur d'habiliter nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs et de tenir un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.
Afin de simplifier le contrôle, l'employeur peut conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale jusqu'à la fin de ladite obligation sous réserve de s'assurer de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.
S'agissant des agents territoriaux justifiant d'une contre-indication médicale reconnue à la vaccination, il leur appartient de transmettre un certificat médical attestant de cette contre-indication au médecin de prévention qui en informe sans délai l'employeur et détermine, le cas échéant, les aménagements de poste et les mesures de prévention complémentaires. En cas de contre-indication temporaire, le certificat produit comprend une date de validité.
2.4 Conséquences du manquement à l'obligation vaccinale
A défaut d'avoir présenté le justificatif précité ou, pour la durée de validité de celui-ci, un certificat médical attestant d'une contre-indication à la vaccination, l'agent territorial concerné ne peut plus exercer son activité. Son employeur l'informe alors sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
L'intéressé peut, avec l'accord de son employeur, poser des jours de congés ou des jours de d'aménagement et de réduction du temps de travail dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur. À défaut, il se voit notifier par tout moyen et le jour même, la suspension de ses fonctions. La notification peut notamment s'effectuer par remise en main propre contre émargement ou devant témoins, d'un document écrit prononçant la suspension des fonctions résultant de l'absence de présentation des justificatifs requis.
La suspension entraîne alors l'interruption de sa rémunération. En ou elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté.
La suspension prend fin dès que l'agent territorial remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.
En tout état de cause, l'employeur peut engager une procédure disciplinaire de droit commun, dans le respect des garanties pour l'agent prévues en la matière.
*******************************************
Les employeurs territoriaux sont invités à entretenir un dialogue social continu et régulier avec les organisations syndicales représentatives sur les modalités de contrôle de la vaccination obligatoire contre -19 et de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire.
Afin de faciliter la vaccination des agents, il pourra utilement leur être rappelé qu'ils bénéficient, en application de l'article 17 de la loi du 5 août 2021, d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19 et qu'une autorisation d'absence peut également leur être accordée lorsqu'ils accompagnent le mineur ou le majeur protégé dont ils ont la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19. Ces absences, tout comme les autorisations d'absence accordées lorsque l'agent souffre d'effets secondaires à la suite de la vaccination, n'entraînent aucune diminution de rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés.
L'ensemble de ces informations est contenu dans la Foire aux Questions (FAQ) relative à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l'évolution de l'épidémie de Covid- 19
DGCL >> Note du 11 août 2021
DGCL >> Questions réponses màj du 11 août 2021

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 13, 2021 3:45 AM
|
L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux et l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie, ratifiées par la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021, adoptée à l'unanimité par le Sénat et l'Assemblée nationale, ont apporté de très nombreuses améliorations au fonctionnement de la formation des élus locaux.
Celle-ci reste structurée autour de deux sources de financement :
- les crédits des collectivités locales pour former leurs propres élus à l'exercice de leur mandat, d'une part,
- et le droit individuel à la formation des élus locaux (DIFE) d'autre part, financé par une cotisation des élus sur leur indemnité de fonction et dont l'utilisation relève de l'initiative personnelle de chaque élu.
Cette réforme conforte le financement de la formation des élus. Elle renforce son financement par les collectivités, en permettant aux établissements intercommunaux à fiscalité propre de soutenir leurs communes membres en prenant la responsabilité, en tout ou partie, de la formation de leurs élus, dans le cadre d'un dispositif souple et basé sur le volontariat. Elle permettra en outre, de mieux combiner les différentes sources de financement.
Lors de leur inscription à une formation, les élus pourront ainsi très facilement, dans le cadre du DIFE, solliciter un complément de financement auprès de leur collectivité territoriale. Pour financer une formation de réinsertion professionnelle, ils pourront également mobiliser les droits acquis au titre de leur activité professionnelle au sein du compte personnel de formation (CPF), en plus de leur DIFE.
Plus généralement, les ordonnances prévoient la rénovation complète du dispositif du DIFE, avec la création d'une plateforme numérique similaire à moncompteformation.fr développée pour les salariés, qui permettra aux élus locaux de comparer facilement les offres de formation et de s'y inscrire directement. Cette plateforme permettra d'accélérer l'entrée en formation des élus et facilitera leurs démarches comme celle des organismes de formation.
Les élus bénéficieront également de droits libellés en euros et non plus en heures, ce qui leur permettra de bénéficier d'une plus grande souplesse dans le choix de leurs formations. Elles renforcent également la gouvernance de la formation des élus locaux, en confiant au Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL) le soin de veiller à son équilibre financier.
Présidé par un élu local, composé d'élus locaux et de personnalités qualifiées, le CNFEL sera consulté sur l'ensemble des questions tenant à la formation des élus locaux, en particulier à la gestion du DIFE (notamment sur le niveau des droits acquis par les élus). Le CNFEL sera en outre chargé d'établir un référentiel dont l'objectif sera de circonscrire le périmètre des formations liées à l'exercice du mandat et éligible, à ce titre, aux fonds publics. Il s'appuiera, pour ce faire, sur un conseil d'orientation, placé auprès de lui, qui sera notamment composé de professionnels du secteur de la formation aux élus.
Enfin, les organismes de formation des élus locaux feront l'objet d'un contrôle sensiblement renforcé. L'agrément qu'ils doivent détenir pour former des élus sur les thématiques liées à l'exercice de leur mandat pourra dorénavant être suspendu, voire leur être retiré en cas de manquements graves, par décision du ministre chargé des collectivités territoriales, après consultation du CNFEL.
Ces organismes seront dorénavant soumis aux mêmes règles de fonctionnement et de contrôle que les organismes de formation professionnelle de droit commun, lorsque leur activité de formation des élus locaux à leur mandat dépassera un certain seuil. Ils devront en outre rendre compte chaque année de leur activité et de leurs résultats.
Cette réforme d'ensemble apporte donc toutes les garanties nouvelles qui permettront aux élus locaux de se former en plus grand nombre, dans le cadre de formations de qualité et adaptées à leurs besoins, et dans des conditions permettant la transparence de l'activité des organismes de formation.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 13, 2021 2:49 AM
|
A l’issue du conseil de défense sanitaire, le porte-parole du gouvernement a annoncé une série de mesures pour tenter de freiner la 4e vague qui frappe la France.
- En Guadeloupe, un confinement renforcé est instauré, similaire à celui déjà appliqué en Martinique.
Les restaurants, bars et plages vont donc devoir fermer.
- la fin de la gratuité des tests de dépistage sans prescription médicale dès la mi-octobre,
- le retour du port du masque obligatoire dans les lieux concernés par le passe sanitaire ;
- une campagne de vaccination à destination des personnes les plus vulnérables face au virus. Elles se verront proposer une 3e dose mi-septembre.
- l’instauration du passe sanitaire dans les grands centres commerciaux, pour les départements où le taux d’incidence dépasse 200 pour 100 000. La décision d’instaurer un passe sanitaire pour les centres commerciaux était jusqu’alors laissée à l’appréciation du préfet.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 13, 2021 2:44 AM
|
L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, prévoit la création d'un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation en remplacement de la précédente charte élaborée par les centres de gestion (CDG).
Sans modifier la structure initiale du réseau des CDG, ce schéma, qui vise à favoriser la mutualisation des missions au niveau régional, traduit l'ambition de renforcer et de favoriser la collaboration entre les CDG d'un même ressort territorial. Il vise ainsi à préciser les missions exercées par le centre coordonnateur et celles exercées par un ou plusieurs centres pour le compte des autres centres. Il vise également à définir les moyens mis en commun pour l'exercice des missions régionalisées.
Cette évolution permet, tout en conservant une proximité avec les territoires, de soutenir le mouvement de mutualisation et de spécialisation des expertises, ainsi que la qualité des prestations des CDG. L'article 14 précité prévoit effectivement que le schéma est transmis au représentant de l'État dans la région, à l'initiative du CDG coordonnateur.
Aucune disposition ne prévoit en revanche l'adoption de ce schéma par délibérations concordantes de chaque CDG concerné, comme c'est le cas, par exemple, lorsque des CDG de départements limitrophes décident de fusionner et de créer un centre interdépartemental unique (article 18-3) ou lorsque des CDG décident de constituer un centre commun (article 14).
Le législateur a ainsi souhaité que l'élaboration du schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation s'effectue dans un cadre souple, laissant une marge de manœuvre aux CDG, ces derniers pouvant toutefois décider de l'adopter par délibérations concordantes.
Enfin, les dispositions législatives sont ici suffisamment précises et ne nécessitent donc pas d'être accompagnées de dispositions règlementaires.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 13, 2021 2:42 AM
|
Les produits, réels ou potentiels, perçus par les collectivités au titre de la taxe d'habitation (TH) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) entrent aujourd'hui dans la composition des indicateurs financiers utilisés de manière transversale dans le calcul de la plupart des dotations et fonds de péréquation. Ces indicateurs sont le potentiel fiscal, l'effort fiscal et le coefficient d'intégration fiscale.
Le nouveau panier de ressources qui sera perçu par les collectivités à compter de l'année 2021 implique donc une refonte de ces indicateurs. Cette nouvelle définition a fait l'objet d'échanges approfondis au sein du comité des finances locales lors de quatre groupes de travail entre janvier et juillet 2020.
A la suite de ces travaux et d'un rapport remis au Parlement sur cette question, la loi de finances pour 2021 a proposé une nouvelle définition des indicateurs. Tout en conservant largement la structure et les finalités de ces indicateurs, l'article 252 de la loi de finances les ajuste pour intégrer dans leur calcul les nouvelles ressources locales, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée et la TFPB communale (dont le montant perçu sera affecté d'un coefficient correcteur). Cette nouvelle définition permettra aux indicateurs actuels de continuer à jouer efficacement leur rôle à l'avenir.
De manière à éviter que cette évolution ait des effets déstabilisateurs sur le niveau des indicateurs financiers des communes, l'article 252 prévoit qu'une fraction de correction sera calculée en 2022 de manière à lisser les variations des indicateurs financiers liées à la réforme du panier de recettes des collectivités locales. Cette fraction de correction diminuera progressivement à compter de 2023, pour s'éteindre en 2028.
Les indicateurs financiers étant calculés à partir des ressources n-1, ce nouveau périmètre n'entrera en vigueur qu'en 2022 (les réformes fiscales n'ont donc pas eu d'impact sur les indicateurs financiers de 2020 et de 2021).
D'ici là, le comité des finances locales pourra, s'il le souhaite, approfondir la réforme des indicateurs adoptée en loi de finances pour 2021. C'est l'objet d'un groupe de travail du comité qui s'est réuni à plusieurs reprises depuis le début de l'année.
|

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 16, 2021 5:33 AM
|

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 16, 2021 5:31 AM
|

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 16, 2021 5:28 AM
|

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 16, 2021 5:25 AM
|
L’obligation de présentation d’un passe sanitaire consiste en la présentation
numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi
les trois suivantes :
• La vaccination, à la condition de disposer d'un schéma vaccinal complet ;
• La preuve d'un test négatif de moins de 72 heures ou d’un autotest négatif
réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé et de moins de 72
heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à
l’évènement ;
• Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du
rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6
mois.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 16, 2021 5:18 AM
|
Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l’épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie
de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 qui a pris la suite de l’état d’urgence sanitaire, créé
par la loi du 23 mars 2020. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures
de prévention adaptées pour concilier la reprise généralisée des activités et de la vie collective avec
une maitrise de la circulation du virus.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 16, 2021 4:57 AM
|
En septembre, le projet de loi de finances pour 2022 pourrait proposer un tout nouveau système de financement de l'apprentissage dans les collectivités. Comme pour alimenter le débat, le CNFPT a tiré le bilan d'une année de prise en charge à 50% des frais de formation des apprentis territoriaux.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 13, 2021 4:19 AM
|
Dans un document mis à jour, la direction générale des collectivités locales explicite la vérification de l'obligation vaccinale à laquelle est soumise une partie des agents depuis le 9 août ainsi que la supervision des autotests pour les agents sans passe sanitaire.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 13, 2021 4:08 AM
|
L'apprentissage constitue un levier essentiel pour l'insertion des jeunes dans le marché du travail.
Pour renforcer son attractivité, un nouvel environnement de l'apprentissage a été créé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, afin de rénover sa gouvernance et son financement assuré antérieurement par les régions. C'est l'institution nationale France compétences qui est désormais chargée de répondre à cette ambition, en devenant le financeur et le régulateur de l'apprentissage.
S'agissant plus particulièrement de la fonction publique territoriale (FPT), il convient en effet d'encourager l'apprentissage en son sein pour contribuer à une meilleure performance de l'insertion professionnelle, investir dans les compétences locales et améliorer l'attractivité des métiers. En 2019, 8 535 jeunes ont choisi l'apprentissage dans la FPT, ce qui représentait la moitié des apprentis du secteur public.
Depuis 2016, le CNFPT est chargé d'une mission de développement de l'apprentissage territorial. Avec la réforme de l'apprentissage et la loi de transformation de la fonction publique, il a donc vu ses missions renforcées. Depuis le 1er janvier 2020, il est ainsi devenu le financeur de la moitié des frais de formation des apprentis, l'autre moitié étant assurée par les employeurs territoriaux, ces derniers ne contribuant pas à la taxe sur l'apprentissage (0,68 % de la masse salariale).
Le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 précise les modalités de prise en charge financière par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) d'une partie des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant. Il prévoit notamment que le CNFPT pourra négocier les montants de la prise en charge des apprentis avec France compétences et, le cas échéant, directement avec les centres de formation d'apprentis (CFA) pour obtenir un coût moindre des frais de formation que celui négocié avec France compétences. Il prévoit également que le financement global du CNFPT sera plafonné annuellement, et que France compétences sera appelé à contribuer au financement par le CNFPT au-delà d'un seuil fixé à 25 M€ pour l'année 2020 par arrêté interministériel du 26 juin 2020. Ce nouveau dispositif s'applique aux seuls contrats signés à compter du 1er janvier 2020.
Avant la réforme, les régions assuraient, volontairement et en dehors de toute compétence obligatoire, le financement de l'apprentissage dans la FPT, à travers des subventions d'équilibre pour les CFA. Ce financement optionnel était inégal sur le territoire, même si la très grande majorité des régions soutenait l'apprentissage dans la FPT. Dans le cadre de la réforme, l'État et France compétences vont continuer de verser chaque année 586 M€ aux régions :
- 218 M€ libres d'emploi pour compenser financièrement la reprise de leurs missions par France compétences, et notamment l'écart entre les recettes et les dépenses destinées à la politique de l'apprentissage ;
- 318 M€ pour continuer à soutenir les CFA au titre des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique (138 M€ pour le fonctionnement et 180 M€ pour l'investissement) ;
- 50 M€ d'enveloppe supplémentaire pour les politiques facultatives à destination des apprentis (financement du premier équipement ou du transport des apprentis…) et le reliquat des primes d'apprentissage versées aux employeurs ou des contrats en cours.
L'action des régions pour soutenir l'apprentissage dans la FPT pourrait ainsi se concrétiser par la poursuite du financement des contrats d'apprentissage en cours, conclus avant le 1er janvier 2020 et le financement du premier équipement, de l'hébergement, de la restauration et du transport des apprentis accueillis dans les collectivités.
Ces financements sont pérennes et permettront aux régions de continuer chaque année à soutenir l'action des CFA notamment en milieu rural, une partie de l'enveloppe étant destinée aux besoins d'aménagement du territoire et de développement économique.
A la suite des difficultés économiques liées à la crise sanitaire, le Gouvernement a lancé un plan de relance de l'apprentissage qui consiste notamment en la création d'une aide financière exceptionnelle (5000 ou 8000€ suivant l'âge de l'apprenti) pour toutes les entreprises et pour les contrats signés entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021. Cette aide a été déployée en deux temps : par le décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2021, puis par le décret n° 2021-224 du 26 février 2021 qui a prolongé cette aide jusqu'au 31 décembre 2021.
En ce qui concerne la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales bénéficient également de ce plan de relance sous la forme d'une aide exceptionnelle forfaitaire d'un montant de 3 000 € versé pour chaque contrat d'apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, conformément au décret n° 2021-340 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant.
Le versement de cette aide par l'agence de services et de paiement est opérationnel depuis le 1er mars dernier.
Enfin, le Gouvernement réfléchit actuellement, en concertation avec l'ensemble des employeurs territoriaux, à un dispositif pérenne de financement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale afin que ces derniers puissent continuer à soutenir ce levier essentiel pour l'insertion des jeunes dans le marché du travail.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 13, 2021 3:47 AM
|
L'Etat a mis en place une enveloppe de 950 millions d'euros (M€) de dotation de soutien à l'investissement local exceptionnelle (DSIL exceptionnelle), destinée à financer les projets liés à la transition écologique, à la résilience sanitaire et à la préservation du patrimoine.
- Au 31 décembre 2020, moins de six mois après son instauration, près de 570 millions d'euros (M€) de crédits avaient été engagés par les représentants de l'État sur cette enveloppe, pour financer plus de 3 350 projets.
- En juin 2021, près de 90 % de l'enveloppe a fait l'objet d'une autorisation d'engagement.
En outre, la loi de finances pour 2021 a institué une autre enveloppe de 650 M€ pour la rénovation thermique des bâtiments du bloc communal. Une instruction du 18 novembre 2020 a précisé les modalités d'emploi de cette dotation d'investissement.
- En juin 2021, déjà 345 M€ ont été engagés pour financer des projets de rénovation thermique.
En outre, une dotation de soutien aux investissements régionaux de 600 M€ a été ouverte.
Ces mesures nouvelles, qui ont été instituées au surplus des dotations classiques d'investissement aux collectivités territoriales (dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)- 1,046 Md€, dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) - 570 M€ et dotation politique de la ville (DPV) - 150 M€), traduisent l'engament de l'État à soutenir l'investissement public local.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 13, 2021 2:53 AM
|
Le décret modifie la composition du Conseil national du développement et de la solidarité internationale fixée par le décret n° 2013-1154 créant un Conseil national du développement et de la solidarité internationale, et plus précisément celle du collège des représentants des organisations syndicales de salariés pour le renforcer et l'élargir aux organisations de jeunes.
Publics concernés : acteurs du développement et de la solidarité internationale : Etat, collectivités territoriales, parlementaires, membres du Conseil économique, social et environnemental, entreprises engagées dans la coopération internationale et le développement durable, chambres consulaires, représentants d'organismes universitaires scientifiques et de formation, organisations de la société civile, incluant les acteurs associatifs, les fondations, les organisations de jeunesse, les organisations syndicales, les acteurs de l'économie sociale et inclusive, les laboratoires d'idées.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 13, 2021 2:47 AM
|
Contraintes physiques, pratique du télétravail, insécurité socio-économique, risques psychosociaux... Un an avant le début de la crise sanitaire et économique liée au Covid-19, dans un contexte de baisse du chômage, comment ont évolué les conditions de travail des salariés ?
En 2019, peu avant la pandémie, les contraintes physiques s’accentuent par rapport à 2005 pour les ouvriers et les employés de commerce et de services, alors qu’elles restent stables pour les catégories les plus qualifiées, qui y sont aussi les moins exposées.
L’usage de l’informatique, déjà généralisé chez les cadres, continue de se diffuser parmi les professions peu qualifiées, mais le télétravail demeure encore peu répandu. L’intensité du travail demeure stable, l’autonomie interrompt son lent déclin.
Le soutien social reste élevé, voire s’améliore encore un peu, tandis que les exigences émotionnelles se stabilisent. Les craintes sur l’emploi diminuent par rapport à 2013 et 2016, dans un contexte d’amélioration de la conjoncture économique.

|
Scooped by
Service Juridique CDG13
August 13, 2021 2:43 AM
|
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est le principal transfert financier de l'État aux collectivités territoriales.
Son montant de 27 milliards d'euros (Md€) est stable depuis 2017, après une baisse de 11 milliards d'euros entre 2014 et 2017. Les critères de répartition de la DGF tiennent compte de plusieurs facteurs, comme notamment la richesse potentielle de la collectivité locale, l'évolution de sa population ou les revenus de ses habitants.
Malgré le nombre important de composantes et de critères de répartition de la DGF, le montant de celle-ci ne connaît que des variations limitées pour la grande majorité des collectivités locales.
Ainsi, plus de 80 % des communes ont connu une variation de DGF en 2021 comprise entre - 1 % et 1 % de leurs recettes réelles de fonctionnement. Seulement 4 % des communes ont connu une baisse de DGF en 2021 représentant plus de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement.
La différence de montant et d'évolution entre la DGF de communes peut par exemple résulter d'une différence de richesse potentielle entre elles, de l'évolution de leur population respective ou de l'écart de revenu moyen de leurs habitants.
En outre, le montant de la DGF ne tient pas directement compte du niveau des taux d'imposition ou de la situation budgétaire réelle de la collectivité, qui dépendent fréquemment de choix de gestion effectués par les collectivités locales. Depuis 2018, l'ensemble des critères de répartition de la DGF, pour toutes les catégories de collectivités territoriales, sont mis en ligne par la direction générale des collectivités locales (DGCL). Un guide pratique de la DGF a été publié en 2021 par la DGCL pour préciser les modalités de répartition de la dotation.
Enfin, la refonte de la fiscalité locale entraînera une refonte des indicateurs financiers utilisés pour la répartition des dotations, déjà engagée par la loi de finances 2021, actuellement débattue au sein du comité des finances locales. Elle sera l'occasion d'examiner un ensemble d'évolutions de nature à renforcer la lisibilité de la DGF
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...